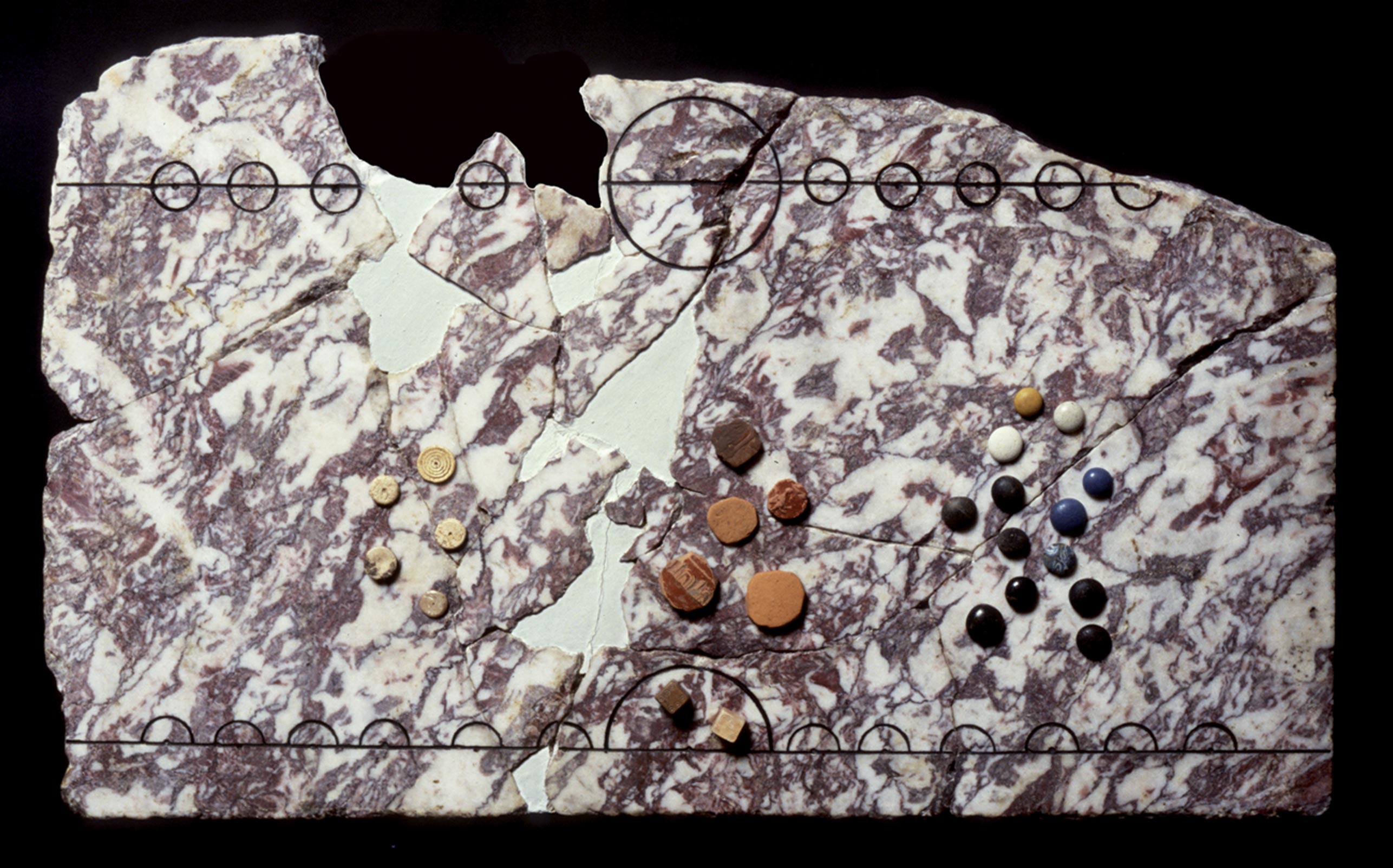Aventicum : une population, un territoire
Livret d'accompagnement (3e étage) (PDF)
Accompanying booklet (3rd floor) (PDF)
L’histoire d’Aventicum débute bien avant la conquête romaine. Une importante agglomération gauloise est notamment attestée dès le milieu du 2e s. av. J.-C., dans laquelle l’aristocratie locale frappe monnaie et commerce avec la Méditerranée.
Dès 15 av. J.-C., le territoire helvète, qui s’étend du lac Léman au lac de Constance, est sous l’emprise de Rome. Avenches en devient capitale et connaît un développement rapide. Sa population, estimée à 20'000 habitants au 2e s. ap. J.-C., est en majorité d’origine indigène. Elle compte des membres de la famille impériale, tels le père de Vespasien et son fils Titus, de grandes familles locales, des citoyens modestes, des médecins, des commerçants et des artisans, hommes libres, affranchis et esclaves.
La ville est en grande partie abandonnée à la fin du 3e siècle, époque marquée par des troubles économiques et politiques. Elle ne sombre toutefois pas dans l’oubli, puisqu’elle est encore siège épiscopal à la fin du 6e siècle, puis une modeste agglomération durant le haut Moyen Age. C’est au milieu du 13e siècle que s’installe la « ville neuve » sur sa colline.